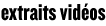|
|||||||||||||||||
| Accueil-mot du
réalisateur |
|||||||||||||||||
|
MOT DU RÉALISATEUR Richard Brouillette J’ai d’abord rencontré Oncle Bernard à travers ses écrits. Chaque semaine, j’attendais avec fébrilité la parution du plus récent numéro de Charlie Hebdo – au Québec, il sort le vendredi – pour pouvoir me délecter de ses chroniques que je lisais toujours en premier, après avoir parcouru les fameuses «couvertures auxquelles vous avez échappé». C’était mon pain bénit, mon petit bonheur des fins de semaine. Car, chaque fois, j’y trouvais des lumières pénétrantes pour m’éclairer sur des aspects de l’économie occultés par les médias de masse ou carrément pervertis par des falsificateurs patentés. Avec une bonne dose de philosophie et d’histoire, Oncle B. présentait sous un jour radicalement différent la théorie et les événements économiques. Il renversait joyeusement les dogmes néoclassiques de la très sainte science économique, en se moquant au passage, avec un humour acéré plein de sagacité, des vains perroquets qui pérorent et professent des lieux communs ineptes, sans jamais prendre la peine de se pencher sur le sens profond de l’économie, du capitalisme, de la richesse, etc. La formidable érudition qui nourrissait ses écrits me rappelait le bel humanisme d’un Anatole France ou même d’un Montaigne. Elle était la marque d’un esprit d’une rare profondeur, propre à déceler et dénoncer les limites de l’économie scolastique, en particulier celles de la micro-économie, pétrie d’un individualisme méthodologique qui laisse entendre qu’il n’y a pas de phénomènes collectifs dans une société, que tout repose sur la rationalité individuelle. Et que dire des traits d’esprit qui faisaient tout le sel de ses textes ! Au plan de l’humour, il n’avait rien à envier aux dessinateurs de Charlie. Combien je me suis bidonné, tout en m’instruisant ! Car, dans ses chroniques comme dans ses livres, il avait la capacité d’édifier les consciences en rendant limpides des sujets que la plupart des gens ne voudraient pas même approcher avec une perche de trois mètres, tout en accrochant des sourires aux visages de ses lecteurs. À cet égard, il n’avait pas d’égal. Lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, en janvier 2000, j’ai été d’emblée frappé par son éloquence et, surtout, son aménité. Je l’ai tout de suite senti animé d’une grande générosité, proche de la fraternité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’était comme si nous avions toujours été potes. Je crois, d’ailleurs, que l’on peut percevoir cette connivence très particulière, attribuable à son grand altruisme, dans l’entrevue que j’ai tournée avec lui, deux mois plus tard, dans le cadre de mon film L’encerclement – La démocratie dans les rets du néolibéralisme. C’était le mercredi 8 mars, dans les locaux de Charlie, peu après la traditionnelle conférence de rédaction. Malgré sa fatigue, il a su endurer une entrevue qui s’est étalée sur environ trois heures, dont environ la moitié fut enregistrée (et 78 minutes filmées). Cette entrevue était particulièrement remarquable. Bernard Maris était en verve, captivant, rigolo et fort naturel. D’ailleurs, à chaque fois que je présentais L’encerclement, c’était immanquable… Comme les intervenants n’étaient identifiés qu’à la fin, lorsque la photo et le nom d’Oncle Bernard apparaissaient à l’écran, les gens riaient et applaudissaient. C’était très certainement la coqueluche du film. Lorsque je me suis réveillé ce triste jour de janvier 2015 et que j’ai pris connaissance de la tragédie en cours, mon sang n’a fait qu’un tour. Et lorsque ce que je craignais par-dessus tout fut confirmé, je ne fus plus qu’un vague ramassis d’affliction. L’âme calcinée, j’ai tout de même songé spontanément à rendre hommage à ces magnifiques irrévérencieux, et plus particulièrement à l’Oncle B., en projetant à mon cinéclub hebdomadaire les rushes bruts de deux tournages remontant à mars 2000 : le bouclage du numéro 404 de Charlie, filmé dans l’esprit du cinéma direct, ainsi que les quatre bobines (sur sept) de l’entrevue avec Maris, que j’avais numérisées pour L’encerclement. À la suite de cette projection, de nombreuses personnes m’ont encouragé à diffuser ces images à un plus large auditoire. J’ai alors décidé de terminer les films, ce qui fut rendu possible avec l’aide de l’Aide au cinéma indépendant canadien (ACIC), de l’Office national du film du Canada (ONF). Par contre, par respect pour les proches des disparus dont les plaies sont toujours vives, j’ai décidé de repousser sine die la diffusion du film sur le bouclage. Au plan formel, Oncle Bernard – L’anti-leçon d’économie procède essentiellement des mêmes principes et partis pris esthétiques que ceux de mes films précédents, dans lesquels les intervenants pouvaient s’exprimer librement, sur la durée. Ainsi, lors de la réalisation de L’encerclement et de Trop c’est assez, il m’apparaissait rédhibitoire d’entraver la parole ou de la conformer au moule télévisuel habituel en lui insufflant un dynamisme artificiel à travers un montage rapide. De même, dans Oncle Bernard, il m’est apparu essentiel de laisser toute la place à la parole de Bernard Maris : libre en ses envolées comme en ses hésitations; tantôt faconde rigoureuse, tantôt murmures en proie aux doutes; verve dénonciatrice tout autant que mutines facéties; une parole laissée aux hasards heureux de la camaraderie et de la bonne intelligence. Aussi, si dans L’encerclement j’ai tenu à limiter mes recours au lubrifiant visuel, i.e. à des images d’archives ou illustratives qui auraient compromis la cohésion du film et qui auraient teinté les interventions des participants du film, je n’en ai pas fait du tout usage dans Oncle Bernard. À mes yeux, il était primordial que la parole pénétrante et captivante de Bernard Maris puisse avoir toute la place à l’écran et que le public puisse se laisser aller, comme moi, à la fascination de l’écouter. Ce parti pris est d’ailleurs indissociable de l’hommage que j’ai voulu lui rendre. Aussi, L’anti-leçon d’économie, dévoile ce qui, en quelque sorte, dépasse du cadre, c’est-à-dire le dispositif cinématographique lui-même (claquettes, fins de bobine, problèmes avec les bruits ambiants, etc.), les discussions entre l’équipe de tournage et Bernard Maris, la présence d’autres membres de la rédaction de Charlie Hebdo, etc., alors que dans L’encerclement, on n’entend pas même mes questions. Cette mise à nu du processus du tournage est importante pour moi dans ce film hommage, car elle nous révèle davantage la belle humanité et la grande générosité de Bernard Maris, de même que la complicité qui s’était installée entre lui et l’équipe. À mon sens, le choix de ne pas intervenir sur le matériau, de ne pas le monter constitue un geste créatif tout autant que 4’33" de John Cage, par exemple. L’un de mes mentors, le cinéaste René Bail, m’avait d’ailleurs suggéré au début des années 90 de ne pas monter Trop c’est assez, de présenter les rushes tels quels. Il faut croire que cette idée s’est frayé un chemin à travers le temps et a fini par s’imposer... Les moments de « noir à l’écran » (une autre idée exploitée par René Bail dans son film Chantier), qui surgissent entre les bobines, agissent de facto comme éléments structurants du discours du film, fonction qui était remplie par des intertitres accompagnés de musique dans L’encerclement. Ces moments de « décrochage » où la conversation diverge et vague en de joyeuses digressions ménagent des respirations bienvenues au cours de cette anti-leçon, finalement assez dense. Qui plus est, lorsque l’écran vire au noir et que la voix de Bernard Maris se prolonge dans l’obscurité c’est en quelque sorte, pour paraphraser la fille de Bernard Maris, Gabrielle Maris-Victorin, une métaphore de ce film hommage lui-même, car c’est comme si la parole d’Oncle B. survivait à sa mort. Rappelons qu’une bobine de 400 pieds (122 mètres) de pellicule 16mm dure 11 minutes 7 secondes. C’est pourquoi nous devons continuellement changer de bobine durant le tournage. C’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de tourner sur support argentique. Car, si le tournage sur pellicule a d’autres avantages (qualité de l’image, durée de conservation en archives, etc.), le fait d’être limité dans le temps et par les coûts du support, constituent un formidable aiguillon qui oblige à la précision, à la qualité. Par ailleurs, j’ai toujours aimé le noir et blanc, en particulier celui des pellicules Double-X et Tri-X de Kodak (le film fut tourné sur Double-X). Et comme j’avais un grand désir de sobriété, de façon à mettre au premier plan les idées et la parole des intervenants de L’encerclement, j’estimais que le noir et blanc se prêterait admirablement bien à cette envie de dépouillement de l’image. Qui plus est, le noir et blanc confère à l’image, en quelque sorte, un caractère d’intemporalité qui sert bien le propos du film, alors que le discours de Maris, tourné il y a plus de 15 ans, est toujours d’actualité. |
||||||||||||||||
| © Copyright 2015, 9086-6351 Québec inc.
Tous droits réservés. Conçu par Prométhée Lefort |
|||||||||||||||||